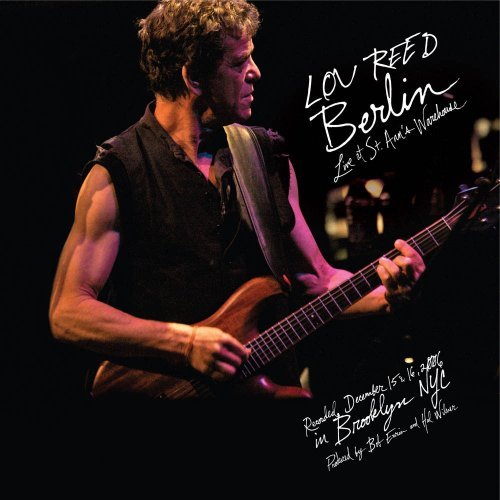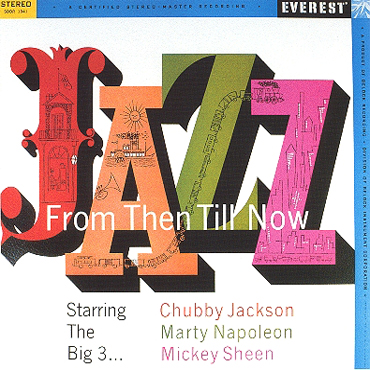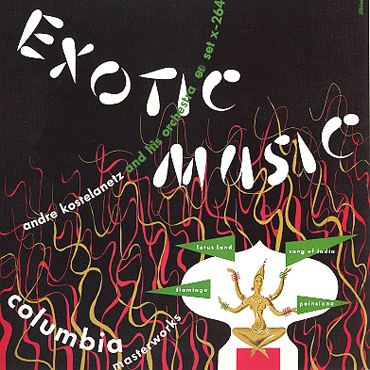Avec le retour du vinyle et les diverses reformations de groupes, jamais l'avenir n'a paru aussi peu attendu, désiré dans le monde musical au sens
large...D'après l'auteur de cet excellent ouvrage, la dernière phase créative en musique date des années 90 et du mouvement techno.
Les innovations technologiques de l'an 2000, loin d'entraîner une révolution musicale révèlent au contraire la pesante tutelle du passé : les archives de la
culture moderne sont librement accessibles sur youtube.
Depuis nous traversons le tunnel du "revival"...
Cédric
Vu sur Arbobo :
Retromania : Simon Reynolds explique le futur antérieur
Obsessions communes
On débutera cette lecture par un nombril, le nôtre. Car on a trouvé dans cet essai replet un enrichissement considérable de
questions qui nous taraudent et sur lesquelles on s’est déjà épanché ici-même. Et puisqu’il est question de l’obsession de l’univers pop (et rock) pour son passé, on saisit la perche pour en
fournir un exemple typique quoique peu glorieux ^^.

Le “futur antérieur”, rien de mieux pour résumer ce bel essai de Simon Reynolds. Ironie du calendrier, nous achevons enfin
notre lecture de Retromania, trouvé à Londres l’été dernier, au moment où sa traduction est sur le point de paraître et fournit l’occasion d’un dossier dans le mensuel GQ. Saluons au passage la
célérité de cet éditeur exemplaire qu’est Le mot et le reste, le vrai grand éditeur rock en France, alors qu’on doit souvent attendre 3 à 10 ans pour lire en français les essais anglophones
importants.
Le sous-titre est explicite : l’addiction de la pop-culture à son propre passé. A peine avions-nous aperçu la couverture que
des articles de notre main nous repassaient en mémoire. Nous n’étions donc pas visionnaire, dommage. Nous ne sommes donc pas brillant au point d’avoir été le seul à identifier quelques traits
saillants de l’époque. Déception.
Déception et contentement de lire sous la plume de Reynolds, plume affûtée s’il en est, un essai riche et stimulant sur
l’incapacité de notre époque à ne pas vivre l’oeil vissé sur le rétroviseur. Car c’est une chose d’écrire quelques pages sur la question, comme nous l’avons fait ici sur la tendance “garage” dans
le rock, ou encore là sur l’incessant revival qui limite l’innovation musicale (je vous recommande hautement les commentaires de haute volée qui sont plus intéressants que l’article lui-même).
C’en est une autre de proposer une étude dense et documentée sur un sujet vaste, aux ramifications profondes. Nous avions-même parlé plus d’une fois des reprises qui se multiplient et sont
devenues un filon à part entière, mais Reynolds lui, s’élève un peu plus et dévoile une vision d’ensemble d’une qualité incontestable. Si l’on insiste, c’est qu’on vient de refermer un des
quelques livres, pas si nombreux, qu’on aurait fantasmé d’écrire nous-même.
Un essai à l’anglaise
Anglais expatrié aux Etats-Unis, Reynolds écrit dans la tradition de ces deux cultures. Le “je” y a sa place sans virer au
nombrilisme ni au gonzo un peu trash. Au fur et à mesure, la première personne, devenue banale avec la multiplication des blogs, se justifie de plus en plus. Lorsqu’il vient à évoquer les
ancrages nationaux, du hiphop anglais et américain notamment, on est frappé avec lui, de réaliser combien il se sent bel et bien anglais, alors que son fils, qui n’a vécu qu’en Amérique, ne
partagera jamais vraiment les mêmes références.
C’est probablement à cette culture d’essai grand public que Reynolds doit de réussir à manier des références pointues sans
larguer ses lecteurs. Références musicales, déjà, puisqu’il se refuse à séparer la culture populaire de genres plus confidentiels, parlant avec la même aisance de Madonna et de Oneohtrix point
never.
Références intellectuelles également, distillées sans ostentation mais à point nommé, Adorno ici, Derrida (théoricien de
l’hantologie) ou Badiou là. Reynolds ne se limite pas à des constats pertinents mais intuitifs, il se documente et nous donne les clefs pour poursuivre l’analyse.
Le syndrôme du rétroviseur, pas si nouveau
“La nostalgie, camarade”, chantait Gainsbourg en 1981, alors que se tournait la page Giscard et que Mitterrand promettait de
“changer la vie”. Message d’avenir s’il en est, mais qui, visiblement, inspirait aussitôt plus de nostalgie que d’enthousiasme. A en croire Reynolds, ce n’est pas une poignée d’artistes qui joue
à “et si on était nés 20 ans plus tôt?”, c’est tout le zinzin qui est coincé, la manivelle a du jeu et la machine d’HG Wells fait tourner les aiguilles à l’envers. Avant on avait Radio
Nostalgiue, maintenant il y a des spéciales “années 80″ en prime time, la chaîne HV1 qui ne diffuse que les clips de notre adolescence, et tout le reste à l’avenant.
En lisant Reynolds, on ne peut s’empêcher d’avoir à l’esprit la série télévisée How I met your mother, qui introduit
une nouveauté perverse, une nostalgie du présent. Drôle et attachante, cette série est aussi terrifiante par son principe : tournée au présent, elle se raconte au spectateur au passé, avec une
nostalgie certaine. Alors que le présent est un futur qu’on entame, il devient ici moins qu’un simple présent, il est déjà du passé avant d’être complètement consommé. Plus de futur, plus de
présent, seul le passé existe, qui dévore tout. Ce simple artifice narratif illustre à quel point la rétromania a bel et bien gagné toute la culture populaire.

La nostalgie occupe une place importante dans ce livre, dont une bonne partie combat l’idée qu’elle serait une manifestation
nouvelle. La culture occidentale était déjà volontiers nostalgique dans les années 1970 ou 1980, Reynolds le démontre sans contestation. Les années 70 regrettaient les fifties, et même le punk en
est la preuve. C’est un moment frappant de la lecture lorsqu’on se trouve opiner sur ce point : les punks ont rompu ouvertement avec les années 60 mais en puisant largement dans la décennie
précédente, celle des balbutiements du rock.
Les revivals non plus ne sont pas si nouveaux, même s’ils sont devenus plus nombreux, et simultanés (c’est la nouveauté des
2000s). Le rétro, le vintage, n’ont pas attendu le 21e siècle pour être au coeur de la mode. Là encore, la spécificité actuelle n’est pas le rétro ou le vintage en soi, mais la place qu’ils
occupent au détriment de tendances nouvelles. Et Reynolds de citer le rétro-gaming. On pourrait aussi penser aux innombrables “nouveaux Beatles” (on ne les compte plus), la nouvelle Janis Joplin
(Izia), le nouveau ci ou ça qu’on désigne donc comme n’ayant rien de nouveau puisqu’on n’a de mieux à dire sur eux que leur parenté avec des artistes parfois morts 40 ans plus tôt. Prolongeons
l’aparté, en rappelant que “the boss” (Springsteen) ou “the godfather of soul” (James Brown) ne doivent leur surnom qu’à leur aura propre, et pas à une comparaison avec qui que ce
soit.
Pas étonnant, dans ce contexte, de voir autant d’artistes reprendre une guitare qu’ils avaient remisé depuis longtemps, ou de
groupes se reformer, aussi bien the Police que… les Sex pistols! No future, peut-être, mais pas sans passé en tout cas. Toute l’industrie musicale fonctionne à plein grâce à son passé, rééditions
à l’identique (Reynolds étudie en longueur l’étonnant cas du Japon), rééditions remasterisées, rééditions avec bonus et coffret, mais aussi tournées anniversaires. On a vu fleurir des tournées où
Sonic Youth, Lou Reed, ou les Pixies rejouèrent, dans l’ordre exact du disque, un de leurs albums emblématiques (Daydream nation, Berlin, Doolittle). Et le public en redemande, les salles sont
pleines.
Quant-à Abba ou Queen, dont plusieurs membres sont encore en vie, ils ont droit à des biopics et des comédies musicales à
succès. L’époque, dans son ensemble, paraît donc gagnée par la nostalgie et une revivalite aiguë.
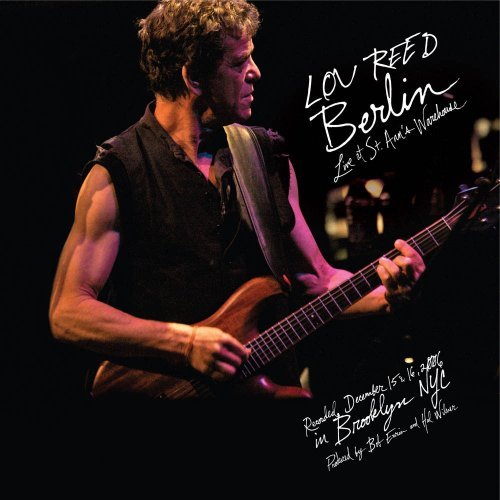
Collectionneur, crate digger et artiste hantologiste : victoire du numérique
Erreur : mémoire pleine. Tel est le message affiché en grand sur l’écran de notre époque.
Abba n’est pas seul à avoir droit à son biopic. Le passé, encore récent, occupe de plus en plus de place dans la pop culture,
Tina Turner a même donné son avis sur l’actrice qui l’incarnera à l’écran. De son propre vivant!
Musée des Beatles à Liverpool, Rock’n'roll hall of fame, expositions sur le Rock’n'roll (Fondation Cartier) voire - un
comble! - sur le punk (à la villa Medici), la culture rock et pop n’est plus seulement une culture vivante au présent, son passé est entretenu, scruté, célébré. La mémoire du passé est si
présente et encombrée qu’elle devient saturée. Reynolds cite ici longuement Huyssen, qui parlait d’un “memory boom”.
Ce travail de mémoire, on le voit aussi hors des institutions. Il y a même des aspects illégaux, avec quantité de blogs dont
le but est de mettre à disposition des disques épuisés, rares ou seulement jamais réédités en CD. Les années 90-2000 ont été celles, sur internet, de mp3 blogs consacrés à l’excavation de disques
oubliés ou inaccessibles. Le moindre groupe, le plus obscur 45 tours, retrouvent une chance d’avoir un public. Reynolds (et nous avec lui) se décrit volontiers en accro de ces sites, passant son
temps à télécharger des centaines d’heures de musique qui resteraient oubliées dans un coin de disque dur sans jamais être entendues.
La technique n’est pas sans conséquence. Elle tient le rôle principal. Le passage de l’analogique au numérique est Le pivot
de toute cette histoire. Avec le numérique, la reproduction à l’identique devient possible sans déperdition et donc sans limitation. Lorsqu’internet se développe, c’est l’explosion. Toutes ces
numérisations, toutes ces copies privées, se trouvent jetées sur des blogs innombrables, à la disposition de tous. C’est l’ère de la “sharity“. Mais aussi celle de l’indisgestion.

Au prix de cette indigestion, des genres entiers ont gagné une visibilité, en particulier la musique d’illustration, library
music, dont on doit avouer être friand et posséder une collection conséquente. Certains passionnés et DJ se sont fait un nom en éditant des compilations de ce type, comme Patrick Whitaker et
Martin Green. De DJ, ils sont devenus “curators” (d’ordinaire c’est la traduction de “commissaire d’exposition”), comme ceux qui publièrent “la crème de la Bosworth Library” en 2002.
Plus aucun disque ne semble tomber dans l’oubli, au pire il trainera dans un bac d’un dépot-vente. Et sera un jour acheté par
un DJ, la culture hiphop étant toujours à la recherche de samples inusités, 2 secondes de trompette ici, un beat de 4s de batterie là… L’ébouriffant Endtroducing de DJ Shadow bouclant a boucle
(jeu de mot), mettant une photo de son disquaire préféré en pochette de son disque construit exclusivement à partir de samples de morceaux existants.
La mémoire devient alors matériau. Au-delà du postmodernisme, Reynolds estime que le phénomène va encore au-delà en incarnant
un genre nouveau. Pour le coup, ah, du nouveau avec du vieux, il n’y a donc pas qu’à se plaindre de la rétromania ;-)
C’est là que l’hantologie fait son apparition.
On aurait pu citer le premier disque de Alpha, Comme from heaven, pour lequel on a un faible et qui utilise par instants la
voix de Sylvia Plath. De son côté Reynolds revient constamment au premiers disques de Boards of Canada pour évoquer ce courant, auxquels des critiques ont plaqué un concept de Derrida. Cool, non?
Après tout il existe bien un groupe baptisé Pure reason revolution en hommage à Kant, et un autre Jean-Paul Sartre Experience, alors pourquoi pas Derrida? On vous laissera savourer les pages sur
l’hantologie, tout aussi bonnes que le reste de l’ouvrage, mais vous commencez à deviner. Il y est question du passé, mais sous une autre forme que la citation (l’usage de base du sample) ou la
reprise ou encore le revival. Acclamé par les milieux electro, BOC proposait d’emblée par la pochette de Music has a right to children une référence lexicale au passé, et une photo de pochette
comme sauvée d’un grenier et où les visages auraient déjà été emportés par la surexposition.
Cette musique là est prisonnière de son rapport au passé, et d’une fantasmagorie ajoute Reynolds, même lorsqu’elle s’efforce
d’aller de l’avant et de proposer une musique originale. Elle porte de bout en bout une nostalgie qui, dirait-on, est son inspiration principale. C’est là le truc flippant, si l’on prend
l’hantologie au sérieux la création du neuf porte constamment la marque du passé, plus que jamais, plus que le rock n’était marqué par le blues par exemple. Reynolds en dit bien plus et le fait
bien mieux, mais le but de cet article n’est pas remplacer le livre, plutôt d’éclairer quelques (bonnes) raisons de le lire ;-)
La technique, donc, au coeur de la rétromania. Comme les visages et les craquelures de la pochette de Music has the right to
children, le son des cassettes analogiques s’évanouit peu à peu. Les ventes de vinyl restent stables depuis des années, voire augmentent un peu, mais Reynolds attire plus notre attention
sur le retour des cassettes. Certains albums sont publiés exclusivement sur ce format, en 2011. Ce n’est pas seulement la musique du passé qui nous aspire, le rapport à la musique aussi a changé
et certains s’efforcent de remonter le temps.
Et le futur dans tout ça?
Dans une ère aussi rétro, que devient le futur? Fait-il encore rêver? On s’écarte un peu du livre de Reynolds pour évoquer
trois exemples. Retour d’abord dans les années 1980, tous les commerces ne juraient que par l’an 2000, magasins d’électroménager et hi-fi, bien entendu (Technic 2000, dans mon ancien quartier),
mais aussi bien des enseignes de coiffure, vêtements, chaussures… Lorsqu’on voit aujourd’hui une devanture **-2000, on sait que le commerce date des années 1980. Un avenir de même pas 20 ans
devant nous nous faisait saliver, rêver. En revanche, le 21e siècle est marqué par le retour des enseignes indiquant “fondé en 2003″ ou “est. 1997″, comme ces vieilles maisons anglaises, on joue
à faire vieux tout en démontrant qu’on vient de naître.
A l’inverse, pour clore cet aparté, le futur est investi par des inventeurs inédits, dont le steam punk est le meilleur
symbole. Les steam punks sont le summum du rétro-futurisme, on invente des machines qui seraient futuristes si nous étions en 1900, comme dans des uchronies dont l’animation japonaise est friande
(Steamboy, Le chateau ambulant). On va chercher le futur… dans le passé, dans une sorte de communion avec Jules Vernes.
Reynolds évoque une “nostalgie du futur”, un peu différente de celle du présent qu’on identifiait plus haut dans How I met
your mother. La puissance d’attraction des sixties, même déformées et fantasmées, tient pour partie à ce qu’elles sont un âge d’or, reconnait Reynolds. Mais c’est aussi une décennie où le futur
paraissait à portée de main, et où le premier pas sur la Lune était, pour des peuples entiers, la promesse de connaître de son vivant la vie sur une autre planète. Ce n’est pas, nous dit-il, que
nous ayons cessé d’innover, internet, le wifi, les voitures électriques, les tablettes tactiles en témoignent. Non, ce qui a changé c’est que ces innovations sont aujourd’hui banales, alors que
dans les années 1960 le futur était excitant. Ce qui a changé serait donc notre regard sur le futur, et notre croyance dans les bienfaits et merveilles qu’il recelait et auxquelles on ne croit
plus. Mais on aimerait y croire, comme ces enfants qui font semblant, et ne disent pas à leurs parents qu’ils ont compris que le père noël n’existe pas, comme déjà nostalgiques de cette magie de
noël évanouie pour toujours.
Dans un article toujours pas démenti, GT relevait que depuis 2000, il n’est apparu aucun genre nouveau (du moins aucun qui
touche le grand public, comme la disco, le rap, le grunge, l’ont fait). Simon Reynolds tient exactement le même langage, et nous conforte également dans nos propres analyses en constatant que “la
nouveauté (au sens de ce qui prend la place de ce qui précède) a remplacé l’innovation”.
Mais ce qui pourrait n’être qu’un constat tourne au paradoxe, car Reynolds insiste sur l’omniprésence des années 1960 ou de
la référence aux 60s dans les multiples revivals et musiques des 15 dernières années. Autrement dit, la culture pop se complaît dans un retour incessant à une époque qui était obsédée par… le
futur! Les 30 glorieuses, et les 60s surtout, sont la période de la conquête spatiale, des débuts de la musique électronique pop, et d’une explosion de science fiction. Ici même on a témoigné de
la floraison, à l’époque, de genres comme le “space funk”, la “kosmische musik”. Le cinéma n’est pas mieux loti, les films de science fiction sont des déclinaisons de films pas tout jeunes (Alien
vs. Predator), ou des remake (La Planète des singes, Star trek, Solaris, l’homme invisible), tandis que la télé qui peine à inventer dans le domaine s’auto-cite abondamment (Stargate, SG
Atlantis, SG Universe). On en revient un peu au steam punk, étonnamment oublié par Reynolds, par la manière de chercher non plus le futur dans notre imagination, mais dans celle de nos
prédécesseurs.
En conséquence, la décennie 2000 sera peut-être la première de l’ère pop à être associée non pas à un style musical, mais à
des objets et technologies (le mp3, l’ipod, le streaming, myspace…).
Hors de la pop occidentale, le salut?
Reynolds a abattu un boulot énorme et jamais son propos ne manque de justesse, ni de matériau. Stimulant, son essai appelle
la discussion et la réflexion, on se sent donc assez facilement autorisé à le prolonger. A notre tour de nous lancer.
D’abord on peut se demander si la sclérose de la poprockosphère (expression maline qu’on doit à François Gorin) n’est pas
limitée au monde anglo-saxon où elle est née. D’année en année des pays inconnus de la carte pop ou rock dans les années 1960 s’imposent, l’Islande, la Suède, le Brésil, la Russie, l’Afrique du
sud… tandis que le blues malien gagne l’Europe ou que le hilife inspire des Vampire weekend, et que le kuduro angolais fait danser sur les pistes européennes. Au Brésil par exemple, on a vu un
boom du baile funk, nouvelle forme de recyclage musical, mais aussi quantité d’artistes électro.
Rien qu’en electro, rien qu’avec le Brésil puisqu’on y est, ces dernières années on a vu de belles réussites dont on retient
Gui Boratto, signé sur un label allemand, et le duo Tetine installé à Londres.
Justement… Tetine n’a pas touché le grand public mais ne fait rien pour. Ils évoluent principalement dans les galeries et le
milieu de l’art contemporain. L’art contemporain, nouveau moteur de la création musicale? Un lieu comme la Gaité lyrique, beau lieu “des cultures numériques” (r)ouvert en 2011 à Paris, fait
volontiers ce pari, tout comme des revues pointues comme MCD (musiques et cultures digitales) ou l’anglais the Wire. La volonté d’innover n’a pas disparu. Mais elle s’est sans doute refermée,
dans les 70s un Bowie était une star mondiale et il ouvrait des portes, tandis qu’aujourd’hui ceux qui se veulent innovateurs évoluent dans des sphères au public limité, limité d’avance
contrairement à l’industrie du disque où un succès mondial inattendu peut parfois survenir.
On apprend beaucoup en lisant ce livre de Reynolds, et on réfléchit. On ne sait plus trop si on doit se plaindre ou non de la
rétromania, mais on en sait plus sur ses ramifications et ses cent visages.
On referme ce livre avec l’étrange sentiment d’avoir eu raison contre soi-même. Avec une grande lucidité, Simon Reynolds se
livre à sa propre critique. A moins grande échelle, comme lui nous avons écumé les bacs de 45t et de 33t à la recherche de pressages originaux, puis fait le tour des mp3 blogs pour y récupérer
des centaines d’albums des années 1950, 60, 70, 80, sans jamais avoir le temps de les écouter par la suite. On a mixé des nuits entières dans des bars en se focalisant sur la soul seventies et
les musiques de films de la même époque. On a contribué à une collection de vieilleries pop-hitsiennes dont d’autres parlent mieux que nous. On a passé des heures carrées dans des friperies pour
y dégoter des pantalons patte d’eph ou de criards chemisiers orange satinés. On a même consacré notre toute première interview à une étoile filante des années yéyé, Jacqueline Taïeb. Autant de
manières de sombrer dans la rétromania qu’on allait finir par dénoncer dans les mêmes pages où l’on en avait fait étalage. Oui, la rétromania existe, et je l’ai contractée. La guérison est
longue, et Simon Reynolds est un remarquable docteur.
Et comme il n’est jamais trop tard pour bien faire : en route pour le 21e siècle!
Arbobo